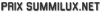M numérique Vs M argentique > duel à coût(eaux) tirés…
| aileka |
|
|
Spécialiste Messages : 2161Depuis le 22 juil 2008 Paris, France |
Excellent! Robert, tu te surpasses! Tu relativises à jute titre le débat numérique/argentique pour le replacer dans une perspective plus large. Difficile de ne pas être d'accord! Il faudrait maintenant une discussion N&B/couleur! En regardant les photos de Fred Herzog, prises en 35mm depuis les années 50, essentiellement des photos de rues de la ville de Vancouver, on pourrait remettre à l'honneur la couleur qui, sur Summilux, semble ne plus intéresser personne. Numérique/argentique/couleur/N&B, l'équation deviendrait plus compliquée |
| aileka |
|
|
Spécialiste Messages : 2161Depuis le 22 juil 2008 Paris, France |
J'ai oublié de citer! Il s'agissait du long exposé de Robert du 14 août. Je suis un peu en retard! |
| MarcF44 |
|
|
Vieux briscard Messages : 3308Depuis le 23 mars 2010 Nantes |
aileka a écrit : ...on pourrait remettre à l'honneur la couleur qui, sur Summilux, semble ne plus intéresser personne. Je pense que les belles photos sont appréciée sur summilux et intéresse tout le monde qu'elles soient en couleur ou en N&B. Le fait est que les photos postées sont majoritairement en N&B mais cela n'a pas de valeur statistique sur leur "valeur", il faudrait demander confirmation aux administrateurs du site mais je pense qu'une majorité de ceux qui consultent le site ne postent pas de photos ni de commentaires. Un exemple : le prix summilux longtemps en N&B a vu un second prix naître cette année sur une série couleur ! (bon ok tu me diras que comme par hasard la couleur est relayée en second choix sur ce coup Par contre le mariage couleur N&B dans un même fil ne passe pas bien je trouve, diviser le forum images en deux me paraît être une bonne idée : Couleur et N&B aileka a écrit : ...Numérique/argentique/couleur/N&B, l'équation deviendrait plus compliquée Je pense que c'est surtout quelque chose qui ne se met pas en équation et que c'est une question de goût d'abord au niveau pratique, certains n'arrivent pas à se plonger dans le labo numérique, c'est comme ça et il faut le respecter...A l'inverse ceux qui ont une bonne maitrise du numérique tendent sûrement à faire de moins en moins d'argentique mais ne se l'interdisent pas pour autant ! Le matériel j'en ai plein le dos ! Plus c'est léger mieux c'est. |
| aileka |
|
|
Spécialiste Messages : 2161Depuis le 22 juil 2008 Paris, France |
C'était évidemment une boutade! Je crois que chacun doit faire ce qui lui plaît. Il faut quand même admettre que l'argentique est de plus en plus une pratique "amateur", et ce n'est pas un terme qui diminue la qualité ou la valeur des images. Les professionnels ont adopté le numérique, à part quelques cas, parce qu'aujourd'hui, la qualité technique du numérique est excellente. Passer du temps à travailler en post-prod est l'équivalent du temps passé dans le labo argentique. C'est beaucoup de temps, et comme le dit Robert, c'est la photo sur papier qui est permet de juger. Donc, on ne peut pas éliminer la post-prod. Personnellement, j'ai abandonné l'argentique dès que les résultats en numérique m'ont satisfait. J'ai passé énormément de nuits dans mon laboratoire pour livrer le lendemain matin des tirages noir et blanc, et même couleur (en moins grand nombre). C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai abandonné rapidement cette pratique. J'aimais bien voir les images apparaître sur le papier dans la pénombre du labo. Aujourd'hui, le travail se fait assis devant mon écran. C'est moins fatiguant, et la marge de manoeuvre des capteurs devenant de plus en plus étendue, j'arrive à des résultats qui étaient impossibles en argentique. Pour ce qui est du débat couleur/n&b, c'est évidemment une question d'affinités. J'ai peut-être fait trop de n&b pour m'y intéresser moins aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas. Je pense néanmoins, et c'est très personnel, que le n&b est beaucoup plus simple que la couleur, non pas au niveau technique, mais au niveau de la vision. On élimine un facteur qui parfois empêche de prendre la photo. Le problème de l'harmonie de couleur, ou de leur contraste, n'existe plus en n&b. On joue sur des équilibres de valeurs. Je mentionnais le travail de Fred Herzog, parce que, justement, il s'est efforcé de prendre en compte la couleur dans des photos de rues, qui à l'époque, étaient essentiellement n&b. C'est un précurseur. Il n'a été reconnu que tardivement, car il montrait son travail en organisant des projections de diapositives. Aujourd'hui, on peut voir l'extraordinaire talent de cet homme modeste, qui a été reconnu sur le tard. Mon tribut à l'argentique!  |
| Max160 |
|
|
Messages : 88 Depuis le 9 déc 2011 Amiens |
MOZ a écrit : Salut Max,Difficile de répondre de façon concise, surtout que ça va faire un peu HS, mais bon. [...] Merci beaucoup pour ta belle réponse ! |
| pierre4215 |
|
|
Habitué Messages : 552Depuis le 1 fév 2013 Saint-Flour (15) |
Robert a écrit : T.U.P.P.A.S.P. : Temps Unitaire Par Photo Aboutie Sur le Papier.Si on part de l'idée qu'une photo n'est aboutie qu'une fois sur le papier, le Temps Unitaire consacré est variable et la valeur de ce temps est très variable pour chacun d'entre nous, sans rentrer dans la polémique des 35 heures ou des RTT. Une photo réalisée avec un Monochrom peut nécessiter des ajustements mineurs et se retrouver sur le papier très vite, si cela est jugé pertinent par le photographe lui-même, voire son commanditaire. Un fichier DNG couleur transformé en noir et blanc prendra plus de temps, un fichier couleur post-traité va demander aussi du temps. Le filière argentique va en demander encore plus, que ce soit via un scanner, de qualité, ou un agrandisseur. Il ne s'agit pas non plus d'opposer "slow" et "fast" food ni de décréter que tel ou tel procédé aboutit dans une catégorie. Ce débat est nul et non avenu s'il ne s'agit que de montrer des images sur le web. L'image finie est sur le papier, AMHA. Les entretiens avec les photographes professionnels publiés dans les revues ou des ouvrages savants montrent que le numérique a pris toute sa place, mais que l’argentique garde des fidèles, soit irréductibles, notamment en moyen/grand format, ou épisodiques, pour des travaux qualifiés de personnels. Presque tous soulignent la réduction de l’offre en papier avec des papiers moins riches que les papiers de la période glorieuse. Cela me rappelle l’impression que j’avais eu en regardant des tirages « vintage » de photos de Lucien Hervé qui voisinaient des tirages modernes : la différence était flagrante malgré la bonne qualité de ces tirages modernes. La gamme de gris était nettement moins riche et le cliché devenait moins intéressant, perdant de sa beauté graphique intrinsèque, s’agissant de constructions de Le Corbusier. Dans le domaine de la couleur, on sait aussi que certains spécialistes comme Roland Dufau emporteront leur spécialité, i.e. le Cibachrome, avec eux dans leur retraite bien méritée, en l’absence de matériau et/ou de successeur. L’importance du tireur est souvent soulignée, venant renforcer l’intention du photographe, intention exprimée à la prise de vue ou a posteriori. On peut imaginer que des « développeurs » de fichiers bruts vont voir le jour en sachant que l’on ne parle pas de manipulation d’image ou d’infographie. La manipulation d’image n’est d’ailleurs pas propre au numérique et le débat entre tirage et traitement des données brutes (« raw ») qui a été suscité par certains festivals (Arles, Perpignan) dans le domaine du reportage n’est pas clos. La démarche reste finalement complexe puisque certains comme Salgado partent de fichiers numériques pour obtenir des négatifs « tirables » en argentique. On voit aussi de plus en plus des tirages couleurs effectués avec des procédés argentiques à partir de fichiers numériques. La motivation n’est sans doute pas que mercantile avec l’arrière pensée de la pérennité chère aux « collectionneurs », collectionneurs sincères ou investisseurs. Le débat sur la pérennité des tirages jet d’encre n’est sans doute pas éteint malgré la qualité des encres et des papiers. Christian Caujolle dans un numéro de Polka (été 2012) rapporte d’ailleurs sur le mode aigre-doux l’accroche publicitaire du photographe de St Antonin Nobleval incitant les amateurs à « développer » leurs souvenirs numériques de façon à les rendre impérissables ! Mais, au-delà de ce débat, le choix du support final est aussi un débat esthétique, un affaire de rendu et de perception, voire de mode. Il ne faut pas non plus oublier que l’outil d’observation, l’appareil, argentique ou numérique, induit un biais dans l’observation par son existence même Il n’y a aucun doute que pour des raisons techniques, on ne photographie pas en argentique comme en numérique. Bien sûr, on peut en numérique photographier comme en argentique, sans utiliser les avantages théoriques du numérique, mais cela demande une attitude réfléchie avec une bonne dose de préméditation… Le fétichisme en rapport avec les matériels ancien est un facteur non négligeable de permanence de l’argentique. Les boîtiers numériques modernes ont généralement assez peu de charme. Un bon nombre de boîtiers argentiques, Leica notamment, ont un charme irrésistible : objet, fabrication, silence de fonctionnement, fonctionnement sans pile pour certains, transmission inter-générationnelle, optiques particulières… C’est un argument d’utilisation non négligeable et les photographes qui feignent de ne pas attacher d’importance au matériel ne disent sans doute pas toute la vérité ! La première raison est celle du nombre de vues. L’appareil classique sur film 35 mm permet d’obtenir 36 vues au format 24 x 36 mm avec une cartouche habituelle et le X Pan permet 20 vues au format 24 x 65 mm. En format 120, on fait 12 vues 6 x 6 cm ou 10 vues 6 x 7 cm. La chambre suppose un changement de film après chaque cliché. Bien sûr, le choix du type de format et du type de film dépend de ce que l’on traite comme sujet : s’agit-il de photographie de rue, de photojournalisme, de paysage, de nature morte, de portrait ou de photographie documentaire sur un sujet donné. Tout photographe finit par savoir qu’il n’y a pas un appareil à tout faire et que l’on peut, à la rigueur, emporter plusieurs types de boîtiers, mais que le dos, celui du squelette, finira par protester et que c’est aussi un bon moyen de ne rien faire de bon ! Si on est vraiment devenu sage, on part avec un boîtier et une seule optique… Le photographe argentiste va donc se trouver confronté à un nombre limité, à un nombre « fini » de vues contrairement à la situation numérique où les cartes modernes atteignent une grande capacité qui donne une autonomie certaine, de plusieurs centaines de vues. Cependant, on retrouve là aussi plusieurs attitudes. Certains photographes prennent plusieurs vues d’une même scène, en argentique comme en numérique, alors que d’autres n’en prennent qu’une, qu’il s’agisse d’un sujet statique ou d’un sujet dynamique. Ces attitudes face à la prise de vue sont l’objet de vastes discussions… Si on ne prend qu’une seule vue, on court le risque qu’elle soit manquée, mais le vrai professionnel, comme William Egglestone échoue rarement. D’autres, sont infaillibles grâce au fameux instant décisif et, tel l’archer zen, prennent la bonne photo au bon moment. Dans certains cas, même Henri Cartier-Bresson prenait plusieurs photos comme en témoignaient les planches contact exposées lors d’une rétrospective au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, il y a quelques années. Dans ces cas, la lecture de la planche contact est enrichissante et permet de faire le choix, ce que les éditeurs/documentaristes font souvent mieux que les photographes eux-mêmes. En numérique, la sélection sur écran, écran de boîtier ou écran d’ordinateur, est finalement difficile et le risque est d’effacer définitivement une photo qu’un autre aurait préféré ou que l’on aurait soi-même préféré quelques années plus tard. L’autre risque est d’être noyé par les photos, trop nombreuses. Enfin, lors de la prise de vue, regarder l’écran LCD de son boîtier peut détourner l’attention de l’évolution d’une scène. On peut donc être tenté de le déconnecter. La rigueur du cadre. La prise de vue est-elle différente ? Bien sûr, tout a été dit sur la prise de vue et son impact sur le produit fini, le tirage sur papier. La plupart des photographes reconnus se distinguent, eux mêmes et sans nuance, des « non-vrais-photographes » comme étant doté de la capacité de regarder, et d’en tirer une photo, et pas seulement de voir. Tout le monde peut voir, mais tout le monde ne sait pas regarder… Le viseur a un rôle essentiel, par le cadre, mais aussi parce que dans le viseur l’œil perd un élément essentiel de la vision qui est la représentation dans l’espace, en 3 dimensions, couplée à d’autres perceptions sensorielles complexes, auditives, mais aussi proprioceptives liées aux multiples récepteurs qui nous renseignent sur la position de nos constituants, i.e. tête ou membres, dans cet espace. Dans le viseur, on ne voit plus qu’en 2D (ou en 2D et demi avec le Leica M à télémètre qui permet de voir en dehors du cadre) et l’image finale est quasiment faite dans le viseur, il n’y a plus qu’à déclencher… Tous les boîtiers ont un format (24 x36 mm pour les 35 mm, formats fonction des capteurs, 4,5X6 cm, 6x6 cm, etc) figé dès le départ. La mode du « non-recadrage avec filet noir » a sévi pendant un moment. Il faut bien avouer qu’en argentique, les possibilités de recadrage sont moindres, et plus difficiles, qu’en numérique (avant l’apparition du scanner de film). La qualité actuelle des images numériques permet assez facilement de recadrer de façon plus ou moins importante une photo sans perte de qualité perceptible. Il est vrai que l’on est parfois un peu trahi par le viseur qui ne couvre pas forcément tout le champ exposé, cas de certains appareils reflex ou des appareils à télémètres, bien que l’on apprenne assez vite à en tenir compte et à cadrer plus serré. Cependant, voir dans un cadre contraint, fût-il rectangulaire, panoramique ou carré, incite à un cadrage plus rigoureux, plus pensé et permet de tracer un pont, modeste et/ou ténu, vers la peinture comme André Lhote ou Daniel Arasse ont pu le faire. Toutefois, il y a de multiples manières de cadrer en fonction du cadre contraint, mais aussi du sujet qui peut être abordé de multiples façons. Gilles Peress livre une réflexion intéressante dans 6 Mois (Printemps/Eté 2012) : « En Irlande du Nord, j’ai expérimenté dix réponses différentes – natures mortes, paysages, instantanés, portraits, plans panoramiques… L’image n’est donc qu’un processus qui va de la perception à la représentation. A Jérusalem-Est, où je travaille actuellement, j’ai d’abord réalisé des « croquis » avec un appareil numérique, et puis, quand je pensais que la forme était aboutie, je réalisais l’image avec un appareil argentique». Enfin, on sait aussi qu’en argentique, l’épaisseur du film par opposition au capteur dont l’épaisseur est quasi virtuelle influence la mise au point et la profondeur de champ, la lumière se dispersant dans la couche photosensible qui est plus ou moins épaisse et repose sur un support. D’autre part, la taille du capteur influence la profondeur de champ : ainsi avec le M8 qui a un capteur plus petit que celui du M9, le facteur étant de 1,33 contre 1, la profondeur de champ est plus grande et la mise au point est plus exigeante avec le M9. En moyen format, 6x6 ou 6x7, on retrouve la même difficulté, ce qui oblige avec faire très attention à la mise au point et/ou à travailler à diaphragme très fermé, sauf effet de flou recherché ! On peut aussi s’interroger sur le choix du mode, noir et blanc ou couleur. La raison peut être simple et pratique : il suffit d’une cuve, de quelques verres gradués et d’un thermomètre pour développer un film noir et blanc. Développer soi-même du film couleur, négatif ou inversible, est plus complexe et nécessite donc une infrastructure plus lourde. D’autre part, le noir et blanc est un mode d’expression bien ancré, même si la couleur est historiquement ancienne aussi… Leica argumente en faveur du Leica Monochrom en disant que 90 % des utilisateurs de M photographient en noir et blanc. On devrait plutôt parler de photo en gamme de gris, ce qui serait moins réducteur !!! Leica fournit le M Monochrom avec un logiciel (SilverEfex) qui permet de simuler le rendu de certains films, ce qui peut paraître paradoxal, mais il faut se souvenir qu’en fonction du type de film, à grain ou tabulaire, le rendu est aussi susceptible de changer assez fortement (contraste, dynamique, structure du grain, etc). La couleur mériterait de nombreux développements, mais c’est un autre sujet (différents types de film, inversible versus négatifs, perceptions et rendus, etc…). D’où vient le charme de l’argentique ? La lecture d’une photographie est-elle conditionnée ? On peu trouver des pistes dans de nombreux entretiens avec des photographes, et dans plusieurs ouvrages sérieux dans l’apparence comme dans la réalité. L’étape du développement a peut-être un rôle : la magie de la révélation retardée face à l’instantanéité numérique… L’image numérique apparaît immédiatement, soit traitée en JPEG par l’appareil, soit en données brutes à traiter. L’essentiel figure donc d’emblée sur l’écran LCD du boîtier puis, rapidement, sur celui d’un ordinateur. En argentique, l’image est latente et il faut la révéler. Il faut donc charger la cuve, mouiller le film, verser le révélateur et agiter pendant un temps assez précis selon les tables de développement et l’effet recherché, arrêter puis fixer, laver et sécher… Ce n’est qu’après toutes ces étapes que l’on peut regarder le négatif, à l’œil nu ou à la loupe, pour essayer de construire une image inversée avec toutes extrapolations possibles. Cette possibilité d’imagination, qui sera parfois déçue, n’existe pas en numérique, même si le « développement » des fichiers bruts laisse place à une certaine interprétation de l’image, sans parler des trucages qui ont toujours existé. La lecture d’une photo La physiologie de la vision telle qu’elle est connue n’apporte pas de réponse flagrante : l’œil participe à la formation de l’image avec ses structures spécialisées, notamment les cônes et les bâtonnets, mais le cerveau fabrique la lecture de l’image par des mécanismes imbriqués qui sont extrêmement complexes. Ces mécanismes se mettent en place progressivement dès la naissance. On sait qu’un nouveau-né est doté d’une vision très médiocre et qu’il acquiert progressivement une acuité visuelle avec un pouvoir séparateur suffisant. Il apprend également la reconnaissance des formes, visage de sa mère par exemple, pour les associer à d’autres éléments, nourriture ou autre... Au fur et à mesure de son évolution, l’homme construit donc des circuits qui pour l’essentiel sont mis en place avant l’âge de 5 à 6 ans. Ensuite, interviennent d’autres processus, notamment mémoriels avec une banque de références dans laquelle le cerveau puise allègrement. La lecture d’une photo tient compte de tous ces éléments et on sait aussi que l’on ne regarde pas les photos des autres de la même façon que les siennes. C’est en partie pour cela qu’il faut aller montrer ses photos à d’autres, photographes ou pas. D’autre part, en argentique, on a soi-même plutôt tendance à regarder l’image dans sa globalité, même si elle est moins nette ou piquée qu’une photo numérique. En numérique, le « crop 100% » favorise la recherche du détail et instille une recherche de résolution spatiale, d’absence de flou de mouvement, sauf option à la prise de vue. La question de la légende, explicative ou induisant une explication, est sujette à un large débat. Certains pensent que la photo doit parler toute seule alors que d’autres pensent qu’une intégration contextuelle aide à voir et à comprendre. Cela peut aussi expliquer que l’on sorte d’une exposition « l’œil en ébullition et l’électro-encéphalogramme plat » selon la jolie expression de Louis Mesplé (Rue89). Le type de sujet a aussi son importance : photojournalisme, documentarisme, voyages, mode, etc… Il n’en reste pas moins qu’un sujet bien construit et appuyé par un travail de compréhension et de documentation aboutit sans doute à des images différentes de celles prises au hasard des rencontres à propos d’un thème. On sait aussi que des clichés pris pour un sujet donné changent d’objet au fil du temps, c’est la revanche de l’archive photographique qui a été le sujet d’une exposition au Centre de la Photographie à Genève en 2010. Cela ramène aussi à la matérialité de l’image et c’est là où l’argentique garde un avantage théorique comme psychologique avec le film et les planches de contact couplées aux tirages de lecture. On peut aussi se souvenir de Winogrand « toute image est le résultat d’une bataille entre le contenu et la forme et le contenu doit l’emporter »… Pour d’autre, c’est la forme qui doit l’emporter (HCB). Pour Gilles Peress, c’est la bataille qui compte ! On voit donc que la lecture d’une photo est conditionnée par le fonctionnement oculaire et le fonctionnement cérébral complexe qui tient compte des différentes éducations (éducation culturelle voire philosophique, photographique, etc). J’ai montré à des publics divers, d’âges différents et n’ayant parfois aucune connaissance photographique véritable, des photos en noir et blanc réalisées en argentique et en numérique imprimée avec la même imprimante. A la lumière de ce qui précède, on n’est pas surpris de constater que les jeunes générations, moins de 25 ans, sont spontanément attirées par les photos numériques alors que les générations antérieures sont plus ambigües et préfèrent en général les photos argentiques. Les photographes, et non des moindres, qui avouent préférer l’argentique ne disent pas réellement pourquoi ou se réfugient derrière des considérations d’habitude ou de technique, archivage notamment. [/b] Gilles Peress donne une partie de la clé du mystère (6 Mois Printemps/Eté 2012) : « Le numérique reproduit mal la frontière entre l’ombre et la lumière, toutes ces nuances que l’on peut capter en fonction de l’ouverture du diaphragme avec un appareil traditionnel. L’image numérique est très plate à la sortie de l’appareil alors que l’argentique donne de l’éclat et de la profondeur. J’ai réussi, après de longs essais, à restituer cet éclat à une vue numérique, mais le résultat n’est pas encore totalement abouti. Je regarde beaucoup les tableaux pour comprendre comment ils ont résolu cette question de l’écart entre la perception et la représentation, comment certains, au-delà du motif, arrivent à restituer un moment cru de vie ». Ellen von Urwerth donne une autre partie de la clé : A la question, posée en 1997, que pensez-vous du numérique ? Elle répond : « pas grand-chose de bien. Je vais continuer l’argentique tant qu’il existera car je pense que le numérique n’est pas plus rapide. C ertes, vous avez les photos tout de suite, mais après il faut faire tellement de retouches qui prennent des heures ; et ce n’est pas véritablement moins cher non plus car les retouches ne sont pas bon marché. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde préfère le numérique à l’argentique. L’argentique est tellement plus magique. Il y a cet élément de surprise. Vous découvrez vos photos et vous vous dîtes « ouah » ! Avec le numérique, vous n’obtenez que ce que vous avez vu. » Bref, chacun voit midi à sa fenêtre et tout ne peut être ramené à une question d'argent  De +, tout évolue... La je dis tout simplement VRAI §§§ Je cherche l'extra dans l'ordinaire... |
| Jean-P. |
|
|
Membre des Amis Messages : 1142Depuis le 21 nov 2012 Clermont-Sur-Berwinne |
J'l'ai pas lu, mais je le jure. Bien à vous. Jean-P. Crains qu'un jour un train ne t'émeuves plus. (Guillaume Apollinaire) !!! |
Retourner vers Leica M : boîtiers
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités